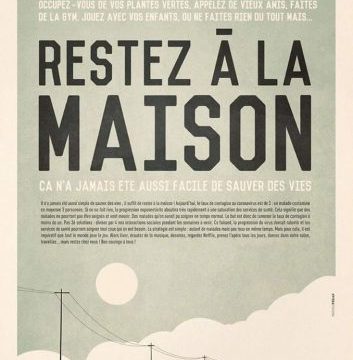Le climat n’est pas une abstraction mais une réalité quotidienne.
On le voit à Ostende où la mer grignote chaque année un peu de marge sur les dunes et où le niveau moyen de la mer1 témoigne d’une hausse de +18 cm en ~70 ans avec une accélération récente proche de 8 mm/an. Fixé au port, le marégraphe2 enregistre cette tendance en mesurant la hauteur d’eau moyenne, lissée mois après mois par rapport à un repère local ; on parle de niveau moyen relatif parce que la mesure intègre aussi les (lents) mouvements verticaux du sol.
À Agadir, l’été 2023 a atteint 50,4 °C (11 août). La région a lancé une usine de dessalement pour sécuriser le robinet quand les barrages faiblissent.
Ensemble, ces signes racontent la même histoire : des risques qui s’installent, des réponses qui s’organisent, et des gestes à faire maintenant.
Le moteur du réchauffement est connu : les gaz à effet de serre (GES)3 — CO₂, méthane… — retiennent davantage la chaleur. La couche d’ozone4, en altitude, filtre les UV : utile pour la santé, mais ce n’est pas elle qui explique la hausse des températures de surface aujourd’hui.
Ozone = UV ; GES = chaleur. Voir le rapport de l’IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change-Un (ONU) ou sa synthèse en français dans le pdf ci-dessous.
Belgique : où et comment ?
Sur la côte, la Flandre applique le Masterplan Kustveiligheid (horizon 2050) : protections dimensionnées contre une tempête millénale 5 et +30 cm de niveau marin. La Kustvisie regarde plus loin, jusqu’à +3 m sur le long terme : plages rehaussées, dunes élargies, digues renforcées.
Lieux sensibles : Nieuport–Coxyde–Ostende–De Haan–Blankenberge–Zeebrugge–Knokke-Heist pour les rechargements de plages et rehausses d’ouvrages (quais plus hauts, renforcement des protections).
Les ports doivent aussi s’adapter : tempêtes sévères, pluies intenses et sécheresses prolongées modifient les profondeurs des voies navigables et perturbent l’accès, le chargement/déchargement et les opérations commerciales. Le port d’ Antwerpen-Brugges déploie ainsi des mesures de protection et d’élévation des infrastructures.
À l’intérieur du pays, l’autre face du risque : pluies extrêmes et crues rapides. En juillet 2021, le bilan officiel fait état de 39 décès en Wallonie. Avec un climat plus chaud, ces pluies très intenses deviennent plus probables ; la gestion des sols et des bassins (désimperméabiliser, ralentir les ruissellements) compte autant que les digues. Les Vallées de la Vesdre, de l’Ourthe, de la Meuse et des sous-bassins urbains accumulent le risque “composé” (sols saturés + crue + surcote6 en aval lors des coups de vent de secteur nord).
Maroc : canicule, sécheresse, incendies, inondationsmais peu d’eau
De Tanger au Sahara, 2024–2025 ont rendu le dérèglement très concret : vagues de chaleur à répétition, bulletins orange de la DGM, pointes 44–47 °C dans de nombreuses provinces. Dans la région du Souss-Massa, ces pics s’enchaînent avec des chergui secs et des orages locaux. 2024 a été classée année la plus chaude observée au Maroc, avec un déficit pluviométrique persistant ; l’été 2025 confirme la tendance avec de nouveaux records mensuels ou stationnels (le pic national de 50,4 °C du 11 août 2023 à Agadir reste, à ce stade, la référence officielle).
Le pays a aussi encaissé des inondations meurtrières : en septembre 2024, des crues soudaines ont fait au moins 18 morts dans le Sud et le Sud-Est (Tata, Tiznit, Errachidia, Tinghir, Taroudant). L’été 2025, le Nord a été frappé par de grands feux de forêts autour de Chefchaouen, mobilisant Canadair et forces au sol. Une météo plus « nerveuse » s’installe : pluies éclairs après longues périodes sèches, vents forts, combustibles plus vulnérables.
Sur le front de l’eau, la sécheresse multi-annuelle maintient la pression : les barrages restent nettement sous la moyenne (environ un tiers du remplissage au niveau national début août 2025, avec des niveaux très bas en Souss-Massa). En réponse, les autorités accélèrent l’adaptation : montée en puissance du dessalement Agadir–Chtouka (environ 275 000 m³/j aujourd’hui pour eau potable et irrigation) avec extension vers ≈ 400 000 m³/j et adossement aux renouvelables (éolien de Laâyoune ~150 MW) ; méga-usine de Casablanca (première phase annoncée fin 2026, montée ultérieure) ; usine de Dakhla (travaux très avancés, mise en service visée mi-2026). À l’échelle nationale : cap sur 17 usines en service, 4 en construction et 9 supplémentaires d’ici 2030, complétés par l’extension du grand transfert d’eau Nord-Sud (« autoroute de l’eau ») et une ligne électrique ~1 400 km pour alimenter les unités de dessalement en énergie renouvelable.
Le littoral concentre une part majeure du risque : selon les évaluations internationales, environ 42 % du trait de côte marocain pourraient être à haut risque d’érosion et/ou d’inondation d’ici 2030. Dans le Souss-Massa, la bande Imsouane–Gouricim (au sud de Tiznit) voit se cumuler recul des plages, salinisation des nappes et submersions lors d’épisodes composés. Les réponses engagées : lignes de recul des constructions, rechargements sédimentaires, restauration dunaire et surveillance renforcée des plages touristiques (Taghazout–Agadir Bay, Aglou).
À l’intérieur des terres, Massa, Tiznit et, plus encore, Taroudant subissent d’abord chaleur, sécheresse et crues éclairs sur les oueds Souss et Massa après de longues périodes sèches. Les mesures se multiplient : plans chaleur (vigilances DGM, horaires adaptés), campagnes feux de forêts (surveillance, moyens aériens), travaux anti-crue sur les points noirs (curage, recalibrage, bassins d’orage), réutilisation d’eaux usées traitées, police de l’eau renforcée et arbitrages d’irrigation en années sèches. Le gouvernement a, en outre, restreint certaines cultures très gourmandes en eau (melons, notamment) dans des zones arides comme Tata et Zagora.
Qu’en est-il du citoyen lambda ? Se sent il concerné par le dérèglement climatique ?
Oui, mais de façon inégale.
En Belgique, la conscience est élevée : en 2025, une large majorité juge le climat « très sérieux » et dit que l’environnement pèse sur sa vie quotidienne — un terreau favorable aux gestes concrets
Côté actes, la Wallonie a dépassé 1 million d’arbres et 4 000 km de haies plantés via Yes We Plant, avec des particuliers, écoles et communes en première ligne. En Flandre, le programme Blue Deal s’appuie sur des projets citoyens (dé-pavage des cours/parkings, jardins qui infiltrent l’eau, citernes) ; les bilans intermédiaires font état de milliards de litres économisés et de milliers d’hectares renaturés, pendant que des campagnes comme le “Tegelwippen” (enlever des dalles pour planter) gagnent le grand public.
Au Maroc, la sécheresse récurrente fait bouger les usages. Quand on pompe plus vite que la pluie ne recharge, le niveau piézométrique baisse : des puits se tarissent, les pompes doivent descendre, l’eau coûte plus cher. Près du littoral (Souss, Chtouka, Massa), cette baisse aspire l’eau de mer : par intrusion saline, l’eau devient saumâtre (brackish), impropre à l’irrigation et à la boisson. D’où un cadre resserré : autorisation obligatoire pour tout forage, moratoires dans les zones critiques, compteurs pour contrôler les prélèvements, police de l’eau sur le terrain (PV, amendes, puits scellés), et quotas de pompage contractuels.
Chez les usagers, l’adaptation est tangible : passage à l’irrigation localisée (goutte-à-goutte), tours d’eau partagés, recherche et réparation des fuites, substitution d’une part des volumes par de l’eau dessalée ou réutilisée pour soulager la nappe.
Ainsi, les agriculteurs ont massivement basculé vers l’irrigation localisée7 : ~824 000 ha équipés fin 2023 (environ la moitié des superficies irriguées), avec un cap à 1 million d’hectares d’ici 2030 — une transition portée, mais aussi choisie, car elle économise l’eau et stabilise les rendements.
En ce qui concerne les nappes aquifères, la loi 36-15 et ses décrets s’appliquent désormais strictement . Les puits ou forages sont désormais contrôlés sur le terrain (saisies de matériels, PV, amendes) par l’ABH Souss-Massa ; certaines provinces, comme Ouarzazate en 2025, gèlent même les nouveaux forages.
Côté arbres et biodiversité, l’initiative reste surtout institutionnelle mais participative : la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 vise 600 000 ha restaurés avec l’appui d’habitants, coopératives et associations ; les points d’étape 2023-2024 montrent une montée en charge réelle, encore perfectible.
En bref, de part et d’autre, la prise de conscience est large (surtout en 🇧🇪, en forte hausse en 🇲🇦 sous l’effet des sécheresses et restrictions). L’appropriation progresse quand l’action publique donne prise aux gens : subventions (goutte-à-goutte, citernes), règles claires (puits), outils simples (dé-pavage, plantations locales). Là où ces leviers existent, on voit des économies d’eau mesurables et plus de végétal dans les quartiers ; là où ils manquent, la conscience reste déclarative et les gestes, sporadiques.
🌍Le constat est incontournable : partout dans le Monde,la mer monte, de plus en plus vite et la terre s’efface !
Le constat est brutal : partout dans le monde, la mer monte — et de plus en plus vite. Le niveau moyen6 des mers bat des records sous l’effet de la dilatation de l’eau et de la fonte des glaces. Depuis 1993, il a déjà gagné plus de 10 cm, un chiffre qui paraît faible mais qui change tout : il double ou triple la fréquence des submersions côtières. Chaque centimètre supplémentaire accroît le risque que les marées hautes ordinaires deviennent des inondations.
Et cela n’est pas une hypothèse lointaine : certaines localités côtières reculent déjà de plusieurs mètres par an, des villages du Pacifique (Kiribati, Tuvalu) ou du Bangladesh disparaissent, et des mégalopoles comme Jakarta ou Miami doivent envisager un repli partiel.
Les cartes du littoral mondial sont en train de se redessiner sous nos yeux.
Les conséquences immédiates se comptent en vies et en déplacements. Les déplacements internes ou migration indigène liés aux catastrophes (inondations, tempêtes, sécheresses, feux) n’ont rien de théorique
En 2023, plus de 26 millions de migrations intra-territoriales ont été déclenchées majoritairement à cause des inondations ou des tempêtes. Fin 2024, près de 83 millions de personnes (soit l’équivalent de la population d’un pays comme l’Allemagne) vivaient déplacées dans leur propre pays — un record absolu, avec une part croissante due au climat. et étaient contraintes de se réorganiser.
À court terme (d’ici 2030), ce sont nos quotidiens qui basculent et ont impact sur notre santé. Les canicules plus longues et pollution accrue augmentent les crises cardiaques, les AVC et les maladies respiratoires. Parrallèlement à cela, la sécurité alimentaire se fragilise avec les pertes de récoltes liées aux sécheresses et inondations. En conséquence, la durée de vie peut se trouver raccourcie. L’OMS estime que le climat pourrait causer plus de 250 000 décès supplémentaires par an dès 2030, par malnutrition, stress thermique et maladies vectorielles.
Aux niveaux de l’Économie et du logement, on constate que la valeur des biens côtiers s’effondre,que les assurances deviennent inaccessibles, et que des millions de foyers doivent envisager de déménager.
En clair, il ne s’agit plus d’une fiction : la montée des eaux, les sécheresses extrêmes, les incendies incontrôlables et les migrations forcées bouleversent déjà notre monde. Sans action rapide, ces phénomènes s’accélèrent et nous rattrapent dans notre durée de vie, transformant nos villes, nos ressources et notre santé au quotidien.
« On fait quoi ? » — stopper, s’adapter pour résister, s’impliquer pour respecter l’environnement
L’équation est simple : on baisse vite (CO₂ + méthane), on s’équipe pour encaisser les chocs, on s’implique pour que l’alerte devienne action. C’est moins coûteux maintenant que d’attendre des fermetures de quais, des maisons inhabitables et des primes d’assurance inaccessibles.
Stopper la trajectoire.
Pour garder une chance réelle autour de 1,5 °C, il faut des émissions mondiales en forte baisse d’ici 2030 (≈ –43 % vs 2019) et zéro CO₂ net vers 2050 ; nos engagements actuels mènent encore au-delà de 2,5–3 °C.
Concrètement : sortir vite du charbon, décarboner l’électricité, électrifier les usages (transports, chaleur), rénover massivement les bâtiments (isolation + pompes à chaleur), couper le méthane (fuites pétrole/gaz, torchage, mines) car c’est le gain le plus rapide possible cette décennie.
S’adapter pour résister (avant 2030).
Côté littoraux, tenir la ligne où c’est tenable, reculer où il le faut : plage + dunes + ouvrages dimensionnés pour des tempêtes « millénales » et +30 cm d’ici 2050 et/ou gestion intégrée, lignes de recul et planification régionale).
Dans les villes : plans chaleur alignés sur les guides OMS (alerte, pièces fraîches, horaires adaptés), toits clairs ou végétalisés pour baisser la température intérieure, désimperméabiliser rues/cours et dimensionner les réseaux pluviaux pour des pluies plus intenses. Ces mesures sauvent des vies dès cet été et évitent des dégâts dès le prochain épisode.
S’impliquer (et y gagner).
Au quotidien, l’action publique se traduit en protection.
On commence par les bâtiments. Audit rapide, étanchéité à l’air, isolation combles et murs. Des protections solaires à l’extérieur. La nuit, on ventile. Moins d’énergie. Plus de confort l’été.
Côté mobilité, on bascule. Plus d’électrique, plus de transport public. L’air s’améliore dès la première année.
L’eau devient un bien précieux. On relève les compteurs, on traque les fuites. Citernes au pied des immeubles. Réemploi des eaux grises. Dans les champs, goutte-à-goutte et tours d’eau réglés au millimètre.
Énergie locale, même règle. Du solaire sur les toits d’immeubles, d’écoles, d’entreprises. Autoconsommation partagée. La facture baisse. La résilience grimpe.
Sur le littoral, on choisit la prudence. Recul planifié, pas de reconstruction au même endroit. Après chaque tempête, on signale les affouillements. On respecte dunes et accès. À la prochaine surcote, ça fait la différence.
Au passage, on y gagne tout de suite : santé, emplois locaux, factures allégées. Et l’addition des catastrophes futures diminue.
- Niveau moyen : c’est la hauteur d’eau moyenne mesurée au marégraphe, mois par mois puis année par année, par rapport à un repère fixe local. On l’appelle “niveau moyen relatif” parce qu’il additionne la variation de l’océan et les (faibles) mouvements verticaux du sol. À Ostende, on observe +18 cm sur ~70 ans, avec une accélération récente proche de 8 mm/an. Autrement dit : la mer monte plus vite qu’avant. (Wikipédia) ↩︎
- Marégraphe : appareil qui enregistre le niveau de la mer par rapport à un zéro local (un “datum”). C’est une mesure relative à la terre où l’instrument est fixé. psmsl.org ↩︎
- Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz présents dans l’atmosphère qui absorbent une partie des rayons solaires et les redistribuent sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, ce qui entraine le phénomène d’effet de serre et une élévation des températures à la surface du globe. ↩︎
- La couche d’ozone ou ozonosphère est la partie de la stratosphère de la Terre qui contient une quantité relativement importante d’ozone. À haute altitude, la couche d’ozone est utile : elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour les organismes. Elle a donc un rôle protecteur pour les êtres vivants et les écosystèmes. ↩︎
- Tempête « millénale » : un événement dont la probabilité est ~0,1 % par an (période de retour ~1 000 ans). Ce niveau est la référence du plan de sécurité côtière en Flandre. (climate-adapt.eea.europa.eu) ↩︎
- Surcote : surélévation météo du niveau marin (vent + basse pression + houle) qui vient se superposer à la marée astronomique ; quand elle tombe à marée haute et avec de grosses pluies, on parle d’inondation composée. (vigilance.meteofrance.fr, noaa.gov, Carbon Brief) ↩︎
- Goutte-à-goutte (en surface ou enterré) : petits émetteurs (2–8 L/h) qui déposent l’eau au pied de la plante/Micro-aspersion / micro-jet : petits arroseurs qui mouillent un disque de 1–3 m autour du pied (vergers, serres). ↩︎