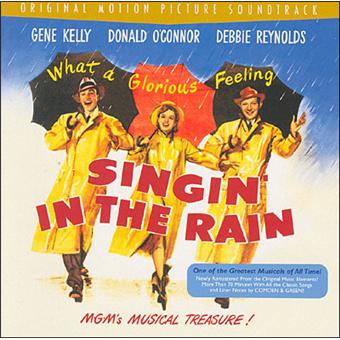L’eau, bien commun menacé : pénuries, poisons et silence coupable
Le grondement sourd des pompes à sec résonne désormais sur tous les continents. Là où l’on redoutait autrefois les inondations, on guette la dernière goutte ; et lorsque l’eau parvient encore jusqu’au robinet, elle arrive chargée d’un cocktail chimique qui échappe aux filtres comme à la vigilance politique.
Selon le dernier état des lieux des Nations unies, la demande mondiale d’eau douce dépassera de 40 % l’offre disponible dès 2030, un gouffre hydrique sans précédent que l’ONU compare à la crise climatique par son ampleur systémique.
Un péril invisible s’infiltre dans nos verres : les « polluants éternels » (PFAS), nitrates et métaux lourds qui contaminent 90% des pluies.
Une crise systémique aussi grave que le dérèglement climatique.
En Afghanistan, Kaboul incarne déjà cette prophétie. Privée de pluies régulières et d’investissements, la capitale fore chaque année quarante‑quatre millions de mètres cubes de plus qu’elle ne recharge : la nappe phréatique s’effondre, les puits domestiques s’assèchent, et certains habitants consacrent jusqu’à un tiers de leurs revenus à acheter de l’eau au marché noir.
De l’autre côté du globe, sur les berges crénelées de Lake Mead (Californie), le Bureau of Reclamation alerte : sauf retournement météorologique, le plus grand réservoir des États‑Unis atteindra son niveau le plus bas en 2027, compromettant l’alimentation de l’agro‑industrie californienne et l’électricité des barrages.
Partout, le même scénario se répète : sécheresses plus longues, canicules plus intenses, nappes surexploitées.
Mais la rareté n’est qu’une face du péril.
L’autre, invisible, se dissout dans chaque goutte.
On a longtemps craint la « pluie acide » au soufre ; voici venir la pluie au trifluoroacétique, résidu aérien des PFAS, ces « polluants éternels » si indestructibles qu’ils envahissent déjà sols, glaciers, vin… et sang humain.
Les scientifiques estiment qu’il n’existe, à ce jour, aucune technologie industrialisable pour extraire ces molécules de l’eau une fois qu’elles y sont dissoutes.
Autrement dit, ce qui tombe du ciel n’est plus forcément potable : l’ère du robinet sans souci appartient au passé.
Belgique : l’eau à haute teneur en PFAS
Partout où la chimie de synthèse s’est imposée, la Belgique apparaît comme un triste laboratoire.
À Zwijndrecht, dans la banlieue d’Anvers, , les rejets historiques de l’usine 3M ont contaminé sols et nappes phréatiques avec des taux de PFAS 500 fois supérieurs aux normes.
La province s’est transformée en terrain d’expérimentation géant : terres excavées, plans d’eau remplacés, zones de jeu interdites.
Plus au sud, en Wallonie, le village de Chièvres découvre qu’il a bu pendant des années une eau chargée des mêmes composés, issus cette fois des mousses anti‑incendie d’une base militaire américaine.
Les premières alertes internes dataient pourtant de 2017 ; les habitants n’en ont rien su avant 2023.
Une enquête parlementaire et des files d’attente pour des tests sanguins témoignent aujourd’hui du choc.
Ces révélations secouent un pays longtemps fier de la qualité de son service public de l’eau.
Elles rappellent, au‑delà du cas belge, la difficulté de surveiller des polluants qui voyagent plus vite que les décisions administratives, et combien la transparence reste l’exception quand la santé publique se heurte à de puissants industriels.
Maroc : sécheresse chronique et cocktail agricole
Plus au sud, le Maroc mène une double course contre la montre : éviter le tarissement complet de ses barrages et freiner la contamination diffuse de ses nappes.
Après cinq années de déficit pluviométrique, le taux de remplissage national des retenues atteignait à peine 28 % en janvier 2025 – un maigre répit, certes en hausse par rapport à 2024, mais encore loin des seuils de sécurité.
Le gouvernement accélère donc les grands chantiers : dix‑sept usines de dessalement fonctionnent, quatre sont en construction et neuf supplémentaires attendent leur feu vert, avec l’appui d’une ligne électrique de 1 400 km dédiée aux énergies renouvelables.
Tandis que la côte se tourne vers l’eau de mer, l’intérieur des terres survit grâce aux forages, et c’est là que s’installe une autre menace : nitrates agricoles et salinisation.
Dans la plaine du Gharb comme sur la Triffa orientale, plusieurs études constatent des concentrations qui rendent l’eau impropre à la consommation, un phénomène aggravé par l’irrigation intensive des cultures maraîchères.
Le royaume a bien interdit les melons et autres plantes gourmandes en eau dans la région de Tata ; mais, sans changement de modèle agricole, chaque hectare planté pèsera sur la nappe un peu plus lourd que l’année précédente.
Un péril vraiment mondial
L’histoire ne s’arrête ni aux frontières belges ni aux steppes marocaines.
Cette double malédiction frappe partout.
En Inde, New Delhi fore sans contrôle le bassin du Gange déjà saturé de métaux lourds.
Le Colorado, fleuve vital pour 40 millions d’Américains, se meurt sous les prélèvements excessifs.
À Cape Town, le spectre du « Jour Zéro » (pénurie totale) hante toujours les mémoires.
La planète glisse vers une économie hydrique de crise permanente.
Pire : les pluies elles-mêmes sont contaminées.
Des études récentes révèlent que 90% des précipitations contiennent désormais des PFAS – ces molécules indestructibles qui s’accumulent dans le sang humain.
Les PFAS, les nitrates, les métaux lourds, mais aussi la surconsommation numérique – data‑centres assoiffés, cryptomonnaies énergivores – transforment chaque mètre cube en objet de convoitise, parfois de conflit.
Les scientifiques européens réclament d’urgence un durcissement des normes, arguant que la pollution chimique franchit déjà les « limites planétaires » ; l’appel, signé par plus de 450 chercheurs, vise explicitement les PFAS dont l’abrogation graduelle est jugée indispensable.
Pourtant, sur le terrain, l’industrialisation continue à vive allure : méga‑bassines en France, plantations d’avocats au Chili, forages de gaz de schiste aux États‑Unis.
Après chaque chantier, il faudra dépolluer et, faute de moyens, on dépolluera peu.
L’impuissance individuelle : le mythe du fait‑maison
Devant ce tableau planétaire, le réflexe premier serait de chercher une solution domestique, comme on faisait jadis bouillir l’eau pour tuer microbes et parasites.
Or la chimie moderne inverse la logique de survie : la chaleur ne détruit ni PFAS, ni résidus pharmaceutiques, ni pesticides ; elle peut même concentrer certains polluants à mesure que l’eau s’évapore.
Les carafes filtrantes ordinaires, les adoucisseurs ou les lampes UV n’y changent rien.
Seuls des dispositifs lourds – osmose inverse à plusieurs étages ou charbon actif haut débit – parviennent à piéger partiellement ces molécules, au prix d’un investissement et d’une maintenance hors de portée de la plupart des foyers.
Autrement dit, le citoyen isolé se découvre désarmé : le salut ne viendra pas d’une bouilloire mais d’une rupture collective avec les sources mêmes de la pollution.
« C’est l’eau qu’on assassine » : l’alarme de Fabrice Nicolino
Dans son pamphlet publié le 21 mai 2025, Fabrice Nicolino jette un pavé de plus dans une mare déjà trouble.
L’auteur, lanceur d’alerte obstiné depuis « Nous voulons des coquelicots », y démonte un engrenage mortel : industrialisation chimique, défaillance politique, illusion technologique.
Il juge impossible de « faire boire propre » une eau déjà saturée de molécules éternelles ; toute stratégie de dépollution massive serait trop lente, trop coûteuse, trop inégalitaire.
L’unique issue, écrit‑il, consiste à « sacraliser » l’eau :
- Interdire immédiatement les substances réputées indestructibles (PFAS et autres),
- Réorienter les subventions vers une agriculture sobre en eau,
- Plafonner la consommation hydrique des data-centres et cryptomonnaies (3 000 litres par transaction !),
- S’opposer activement aux privatisations déguisées et à la bétonisation des bassins versants.
En somme, fermer le robinet de la pollution avant que la planète entière ne voie le sien se tarir.
Le constat glace autant qu’il mobilise : si la pénurie frappe déjà des millions de personnes, l’empoisonnement, lui, n’épargne plus personne.
Le miroir brisé
Nous sommes faits d’eau à 60%. L’asphyxier par la rareté, l’empoisonner par négligence ou cupidité, c’est scier la branche où l’humanité est assise.
Fabrice Nicolino rappelle que chaque crise hydrique écrite d’avance est peut‑être la dernière chance d’un sursaut collectif.
À chaque citoyen de saisir cette alerte avant qu’elle ne s’évapore, comme tant de rivières.
Sources
Rapport mondial des Nations Unies sur l’eau 2025, Zwijndrecht : Rejet des PFAS autour de 3M, Chièvres : 12 000 Habitants Exposés aux PFAS, Helft Omwonenden Heeft Te Veel PFAS In Het Bloed (VRT NWS), Één Op Twee Inwoners Te Hoge PFAS‑Waarden (De Standaard), Taux De Remplissage Des Barrages Marocains (Hespress), Données Barrages Maroc 02/01/2025 (Médias24), نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 %, Le Maroc Vise 1,7 Milliard m³ D’eau Dessalée D’ici 2030, المغرب يسرّع مشاريع تحلية المياه, Du TFA Détecté Dans Des Vins Européens (Le Monde), Quelles Solutions Face Aux PFAS ? (CNRS), Kaboul Face Au Risque D’un Avenir Sans Eau (France 24)